Menu dicos | Tableaux d'équivalences, préfixes, désignationset autres broquilles |
| RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS UTILES... | |
|---|---|
Outre les acronymes, sigles et autres abréviations, le vocabulaire scientifique, technique et militaire recourt à un certain nombre d'unités de mesure, de préfixes et désignations qui sont récapitulés ici.
| |
| Equivalences des grades militaires |
|---|
|
Quiconque a dû se frotter un jour à la traduction d'un texte où interviennent grades et hiérarchie militaires sait la difficulté que représente la tâche. Mince consolation, plusieurs officiers m'ont avoué avoir rencontré le même genre de problème lors de réunions de l'OTAN ou de manuvres conjointes... Les problèmes de préséance et de hiérarchie y sont souvent plus inextricables que dans la plus délicate négociation diplomatique. Ces quelques tableaux sont sans doute encore entachés d'approximations (la correspondance des grades n'est absolument pas bi-univoque et les faux-amis y sont légion). Par ailleurs, ils ne prétendent pas à l'exhaustivité - se réduisant aux trois grandes armes pour les forces armées française, américaine et britannique, tout en se cantonnant à la période contemporaine (XXe-XXIe) siècles. J'en profite pour remercier ici (entre autres) Jean-Claude Michel, J. Fischer (alias Kanemoto44, Catherine Alhinc et Thierry Pouliquen pour leurs précisions et rectifications. |
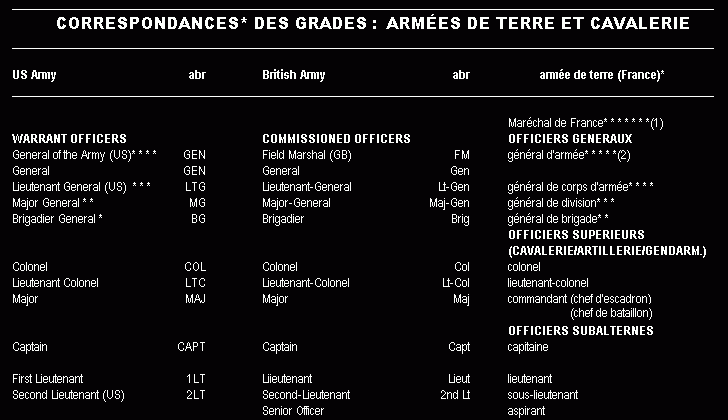
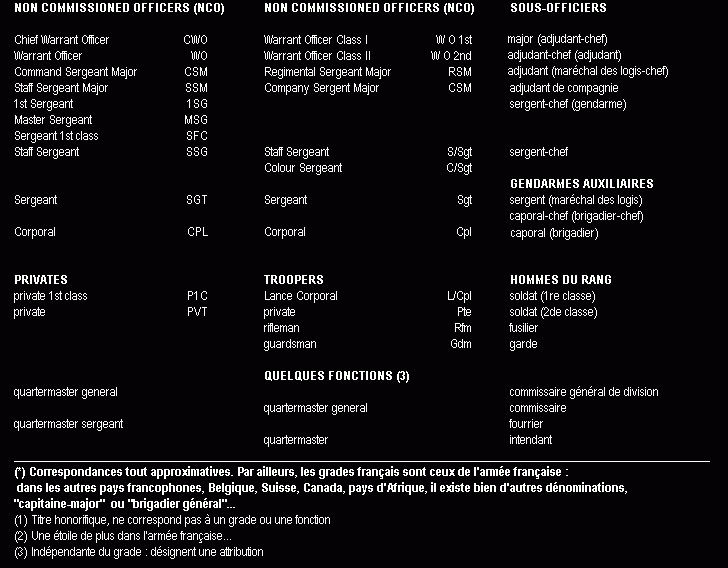
|
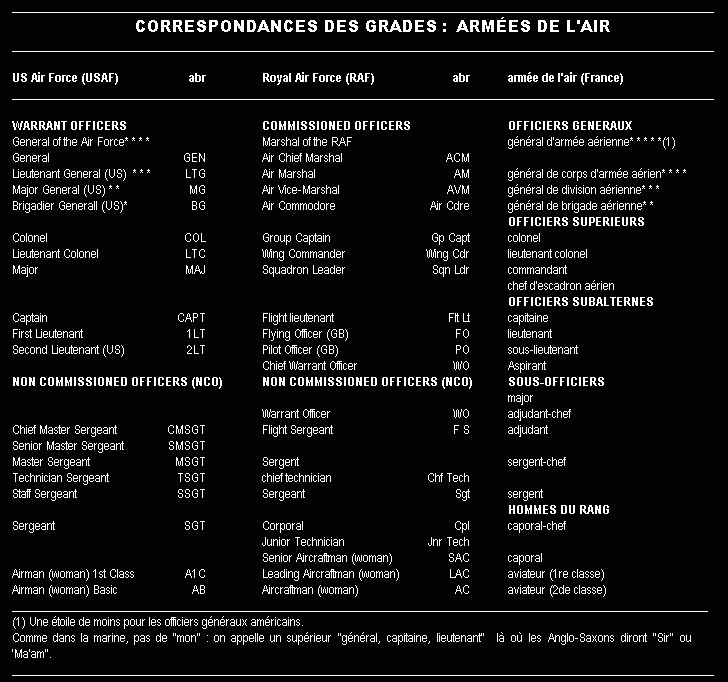
|
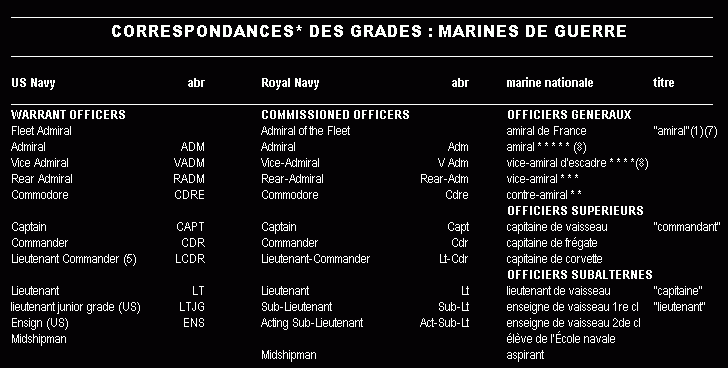
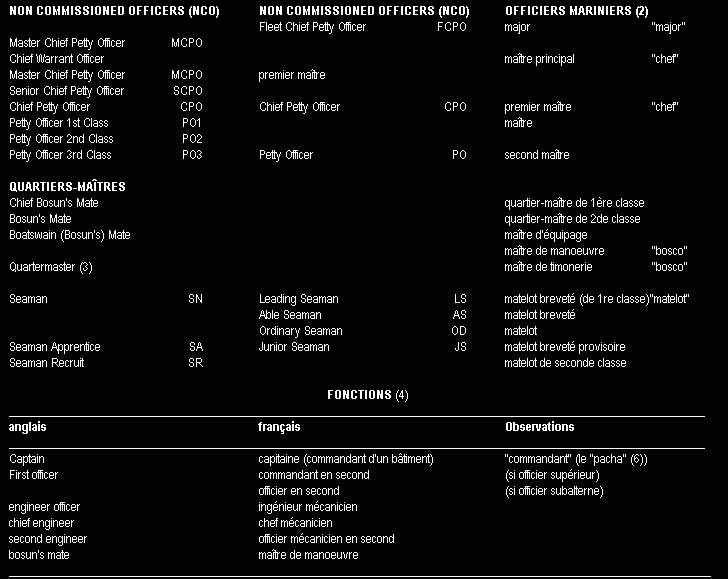
|
|
(*) Correspondances tout approximatives. On notera en particulier la démultiplication des grades intermédiaires dans les marines anglo-saxonnes...
(1) Entre guillemets, titre donné en France à un supérieur quand on s'adresse à lui. Dans la marine, comme dans toutes les armes en pays anglo-saxons, c'est bien sûr le règne généralisé du "Sir". Et bien entendu, contrairement à l'usage de l'armée et de la cavalerie, dans la marine et l'aviation, pas de "mon" capitaine ou "mon" lieutenant. (2) La correspondance n'est pas stricte : ainsi, le grade de premier maître français est intermédiaire entre chief petty officer et master (fleet) chief petty officer. Et selon les sources (et l'époque), le Petty Officer 3rd Class sera assimilé à un second maître ou à un quartier-maître, le boatswain mate à un quartier-maître, un maître d'équipage ou un maître de manuvre... (3) Attention à la confusion : le quartermaster anglais ou américain désigne une fonction : intendant (armée), maître de manuvre (dans la marine), en tout cas, ce n'est pas un quartier-maître. (4) Distinguer le titre (grade) et la fonction (poste) : celui qui commande un navire en est le capitaine ("seul maître à bord après dieu"), quel que soit son grade par ailleurs. De même pour le second ("First officer" en anglais) qui est son lieutenant (étymologiquement : "tenant lieu de"... en cas d'absence ou de défaillance de son supérieur). D'où le casse-tête des malheureux traducteurs et les confusions répétées de doublage de films ou séries télévisées. (5) A ce propos, petite parenthèse StarTrek : Cette confusion, on la constate, tant avec le "lieutenant commandeur" Data ou le le "Premier officier Ryker", ce dernier même tout simplement qualifié de "Numéro Un" (un comble pour un second), sans oublier les capitaines Kirk, Picard ou Sisko. Notons en revanche, dans les films tirés de la série Next Generation, l'effort louable des adaptateurs qui n'ont pas hésité à attribuer aux protagonistes leurs véritables titres de "capitaine de corvette" (Data) ou "lieutenant de vaisseau" (Worf). On notera au passage qu'en toute logique, puisqu'il s'agit de vaisseaux spatiaux, ce sont bien la terminologie et les usages de la marine qui s'appliquent (préfixe USS pour les bâtiments, usage du sifflet, grades et titres...) et non ceux de l'armée de l'air. (6) Les seconds étant les "barons". (7) Dignité de l'État et non pas grade (au même titre que "Maréchal de France"). Il a existé avant la Seconde Guerre mondiale une dignité de "Maréchal de la Flotte" qui n'eut qu'un seul titulaire : l'Amiral François DARLAN, à l'époque Chef d'état-major général de la marine. (8) Il s'agit là non pas de grades, mais de rangs et appellations. Les vice-amiraux (3*) titulaires de certaines fonctions (chef d'état-major de la marine, directeur du personnel militaire de la marine, commandant la force d'action navale, etc.) peuvent accéder, en effet, aux rangs et appellations d'amiral et de vice-amiral d'escadre. Enfin, une précision sur l'appellation "commandant" : dans la marine, tout marin quelque soit son grade à droit à l'appellation s'il est responsable d'un bâtiment, on dira donc "commandant" à un quartier-maître s'il est maître à bord d'une chaloupe (merci à J.Fischer alias Kanemoto44 pour cette remarque). Pour plus de précisions, on consultera utilement le site officiel de la marine nationale et plus particulièrement la page consacrée aux grades Précisions complémentaires sur le jargon de la marine
(merci à Bernard Schmitt pour ces indications) « Pour information [- dans la marine française - ], lorsque l'on interpelle une personne ayant pour grade :
|
| Unités de mesure |
|---|
En navigation maritime ou aérienne*, on emploie toujours ces unités non métriques :
* Ou utiliser un convertisseur en ligne comme Megaconverter. |
| Tableau des fréquences radio-électriques |
|---|
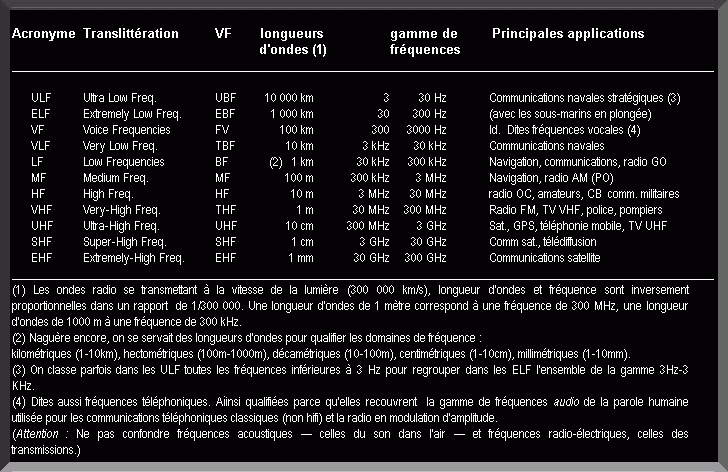 |
|
L'antenne d'émission (ou de réception) ayant une longueur inversement proportionnelle à la fréquence, on voit immédiatement que si un fouet de quelques centimètres suffit pour un téléphone mobile et un rateau de quelques dizaines de centimètres pour capter la télévision hertzienne, la radio en modulation d'amplitude exige des mâts de plusieurs centaines de mètres de hauteur.
Quant aux communications avec les sous-marins, elles nécessitent côté sol des antennes installées à l'horizontale sous la forme de ligne de plusieurs kilomètres et côté engins mobiles (avions ou sous-marins) de longues antennes filaires remorquées qu'on déploie à l'arrière de la carlingue ou de la coque au moment de la transmission. Pour les communications en ultra-basses fréquences, on est contraint de recourir à des couplages d'antennes ou des réseaux interférométriques séparés parfois par des milliers de kilomètres... Autre problème, la densité d'information véhiculée étant inversement proportionnelle à la fréquence utilisée, on saisit d'emblée qu'il n'est pas question de transmettre en temps réel de la vidéo haute définition entre la terre et un sous-marin en plongée. |
| Classification des missiles balistiques et de croisière |
|---|
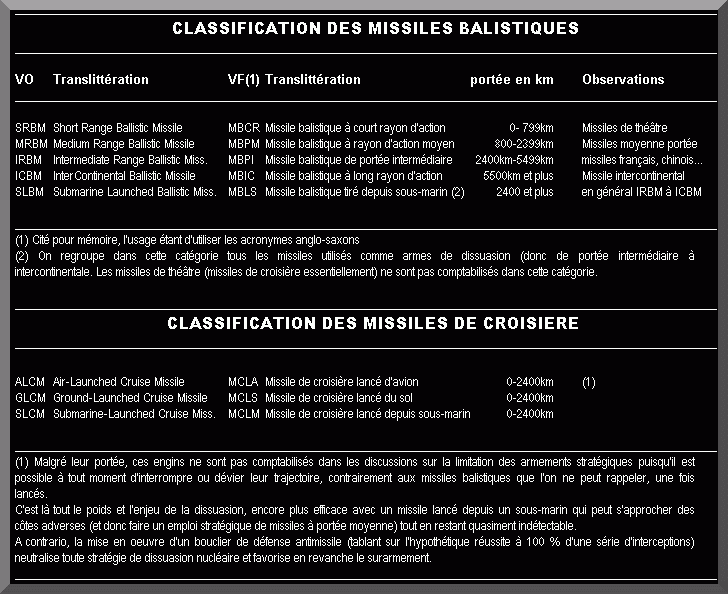 |
|
Le tableau ci-dessus synthétise la classification des missiles balistiques communément admise en matière d'armement (systèmes ABM) et de géopolitique (en particulier pour les négociations et les traités SALT et START).
Pour ce qui est des engins tactiques à courte et moyenne portée (missiles et roquettes), ce clivage est devenu peu à peu obsolète avec l'apparition d'engins polyvalents comme le missile français Matra MICA dont la portée va de 100m à 100km... La différence essentielle s'établit désormais selon la manvrabilité de l'engin et son mode de guidage/détection. |
| Préfixes & Dénominations des matériels | |
|---|---|
Toutes les forces armées sont friandes d'acronymes (songeons au tristement célèbre STUKA allemand, qui signifiait STUrzKAmpfflugzeug, soit bombardier en piqué).
Dans le cas des forces armées américaines, (Army, Air Force, Navy, Marine Corps, National Guard), elle attribuent à leurs matériels une ou deux lettres préfixes indiquant la catégorie de l'engin, suivie de chiffres précisant son type (les numéros sont en général attribués dans l'ordre chronologique de réception par les diverses armes), éventuellement complété d'une ou deux lettres-indices pour distinguer les variantes ou évolutions dans la série du type. En outre, ces appareils héritent traditionnellement d'un nom de baptême : ainsi le F-105G est un chasseur (F=Fighter), type 105, dit "Thunderchief", en l'occurrence du modèle biplace équipé pour les contre-mesures électroniques (série G). En voici (en couleur), pour les matériels aériens, les principales catégories (éventuellement précédées d'une lettre-indice complémentaire précisant les attributions de l'appareil : D (drone), contrôle ou transformation, N avion sans pilote téléguidé (servant d'engin-cible ou d'appareil de reconnaissance), W (Weather), avion de surveillance météo, K (Kerosene), avion-citerne de ravitaillement en vol, etc.
On notera par ailleurs qu'un remaniement est intervenu après la création en 1947 d'une armée de l'air autonome, l'US Air Force, en remplacement de l'United Army Air Forces (USAAF), qui avait elle-même succédé à l'USAAC, US Army Air Corps, durant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut en effet l'occasion du remplacement d'un certain nombre de catégories tombées en désuétude ou au contraire de l'apparition de nouvelles. Ainsi, les chasseurs-intercepteurs, indicés "P" (Pursuit) deviennent-ils des "F" (Fighter), les voilures tournantes -- "R" pour Rotary -- deviennent "H" (Helicopter). On assiste de même à une simplification de certaines catégories. En jaune, les désignations spécifiques à la RAF. | |
Ajoutons ces indices, utilisés en suffixe par la Royal Air Force
| |
| Désignation OTAN des matériels soviétiques | |
|---|---|
|
Pendant la Guerre froide, l'OTAN a systématisé le procédé avec les appareils et engins soviétiques (dans l'attente de connaître leur désignation officielle), en leur attribuant un surnom dont l'initiale faisait référence à la classification américaine : chasseurs MIG-25 « Foxbat » ou Sukhoï Su-15« Flagon », bombardiers Myasichtchev Mya-4 « Bison » ou Tupolev-22 « Backfire ». | |
Ce système de codification avec lettres-indices et numéros matricules s'applique également aux autres armes et matériels (véhicules de l'Armée de terre, bâtiments de la Marine, armes d'infanterie, radars, missiles, etc.) : ainsi, les porte-avions sont-ils affectés des lettres-indices CV (Carrier Vessel) et CVN lorsqu'ils sont à propulsion nucléaire. | |
| Préfixes & Dénominations des matériels russes et soviétiques | |
|---|---|
|
Les forces armées russes et précédemment soviétiques recourent elles aussi à des lettres indices pour désigner les diverses catégories d'appareil. En revanche, contrairement à l'usage occidental, l'indice initial n'identifie pas les catégories génériques (chasseur, intercepteur, bombardier, transport...) mais les "bureaux d'étude et de production", baptisés du nom de leur fondateur ou de leur ingénieur principal et dont les principaux sont (ou ont été) : | |

| |
|
Cette procédure a été appliquée à partir de 1941. Antérieurement, les appareils étaient désignés par leur fonction (voir tableau).
Enfin, depuis l'éclatement de l'Union soviétique, l'essentiel de l'industrie aéronautique a été privatisé (entre autres l'hélicoptériste Mil). Par la suite, plusieurs décrets présidentiels russes de 1995 et 1996 ont décidé d'une intégration verticale des structures d'étude et de production, regroupant bureaux d'études, constructeurs, intégrateurs, motoristes et équipementiers. Schématiquement, l'industrie aéronautique russe encore partiellement contrôlée par l'Etat comprend désormais quatre grands groupes : | |
| |
Dénominations des appareils soviétiques jusqu'en 1941 (Quelques exemples :) | |
| |
|
Un certain nombre de ces suffixes sont encore utilisés aujourd'hui, mais la plupart désignent plutôt des sous-catégories très précises, avec tous les panachages possibles (par exemple : TM : bombardier de série, LSh= Avion d'attaque léger, K [Kommertskeski] commercial => variante export, etc.
Sans compter bien sûr, le numéro de type et les lettres A, B, C... qui indiquent classiquement les variantes successives, ce qui peut amener à des matricules dont la longueur n'a rien à envier à celle des matériels ferroviaires (**)... | |
| |
|
* Ce qui explique pourquoi les avions dessinés par Nikolaï N. Polikarpov mais encore produits après sa disparition en 1944, n'ont été baptisés "Po" qu'à titre posthume. C'est ainsi le cas du célèbre U-2 d'entraînement, devenu Po-2 et fabriqué de 1927 à 1953 à plus de 40000 exemplaires... record du monde à ce jour inégalé !
(^) ** Par exemple : avant l'introduction du code UIC informatique à treize chiffres, une voiture SNCF Dqd2myfi était un fourgon à bogies à compartiment douanable, à caisse métallique, frein continu et intercirculation par soufflets. Une voiture A3cB5c, une voiture mixte à trois compartiments de première, 5 de seconde transformable en couchettes... Mais ceci est une autre histoire.(^) | |